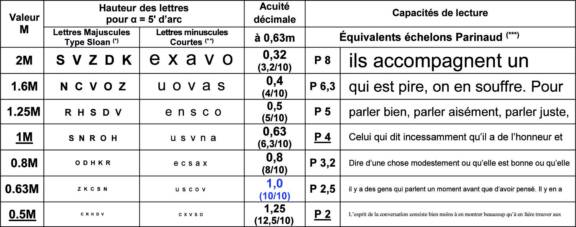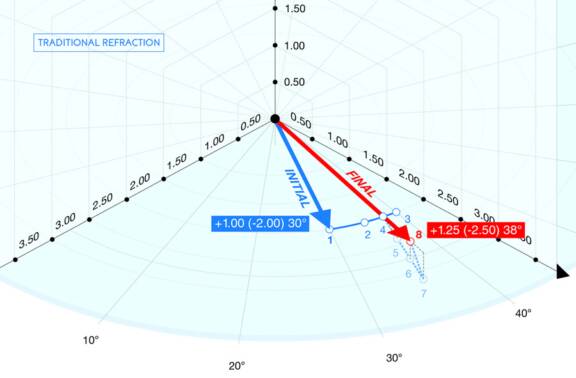Équiper un anisométrope en verres progressifs : mission impossible ?
Nous savons qu’une anisométropie corrigée en lunettes engendre un certain nombre de contraintes qui rendent l’adaptation souvent délicate. Un verre de lunettes a vocation à dévier les rayons lumineux afin de rapprocher l’image de la rétine. Des verres différents sur les 2 yeux ne vont donc pas dévier les rayons de la même façon. Les « effets secondaires » de ces corrections ne seront donc pas les mêmes. Toute la question est de savoir si le couple œil-cerveau est capable de supporter ces différences pour fusionner les 2 images.