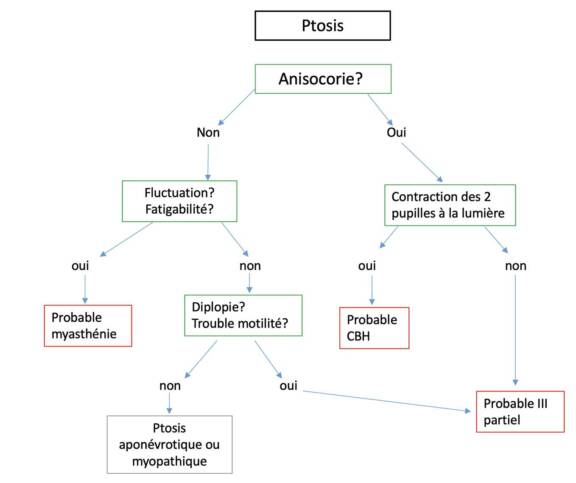Rapport SFO 2020. La neuro-ophtalmologie à l’honneur !
Ce congrès de la Société française d’ophtalmologie (SFO) a été marqué par des communications passionnantes concernant la neuro-ophtalmologie. En effet, le millésime 2020 du rapport de la SFO y est consacré, dans la lignée des précédents rapports dont celui de 2004 coordonné par le Pr Safran. Sa version papier et le format PDF seront disponibles en mai 2021. Le rapport a été présenté par le Dr Catherine Vignal-Clermont et le Dr Cédric Lamirel.