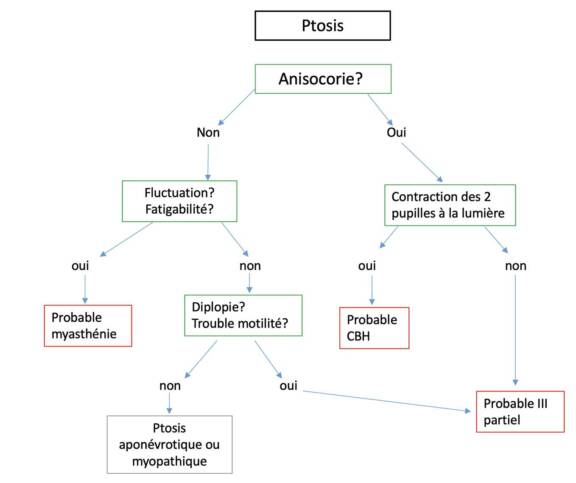Quand le cortex s'invite aux urgences ophtalmologiques
Nous rapportons le cas de Mme F., âgée de 71 ans, d’origine grecque, qui a consulté à plusieurs reprises aux urgences ophtalmologiques pour un trouble visuel s’aggravant rapidement.
Points forts
• Le diagnostic de cécité corticale doit être évoqué devant un tableau de baisse d’acuité visuelle, fond d’œil normal et RPM préservés.
• La cécité corticale est la conséquence de lésions occipitales bilatérales et peut s’accompagner d’autres syndromes neuro-visuels tels qu’une agnosie des couleurs ou un syndrome de Balint selon la topographie de l’atteinte.
• Il s’agit d’un diagnostic difficile qui est orienté à l’aide de tests de dépistage clinique simples, et qui ne doit pas être méconnu car les étiologies sont parfois graves.