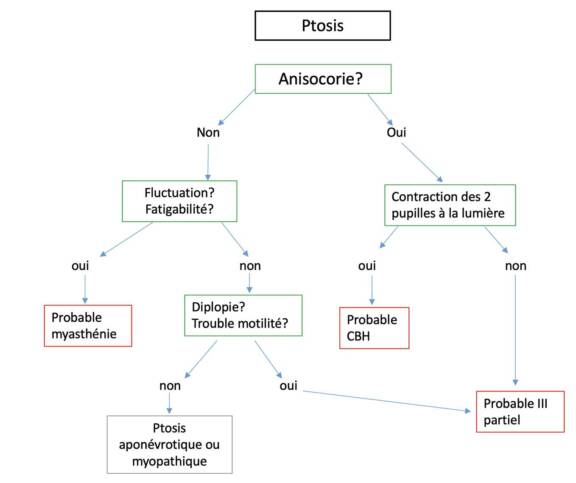Les plaies orbitaires
Les plaies orbitaires sont des pathologies rares pouvant menacer le pronostic vital du patient. Elles sont l’apanage des hommes jeunes dans un contexte de rixe et d’éthylisme. Certains pièges diagnostiques et thérapeutiques peuvent engager la responsabilité de l’ophtalmologiste.