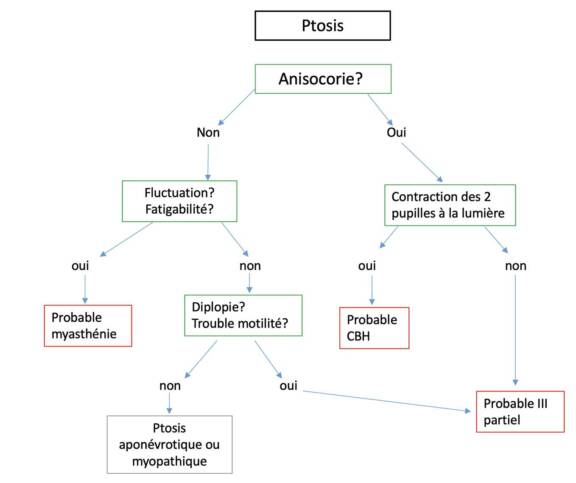Echos SFO 2018. Quoi de neuf en neuro-ophtalmologie ?
Les communications de neuro-ophtalmologie ont abordé cette année des problématiques variées. On peut ainsi citer les avancées diagnostiques et thérapeutiques présentées lors de la session du DHU Vision et Handicaps, les controverses sur la place de la corticothérapie dans les neuropathies optiques lors du symposium franco-maghrébin, et les urgences lors de la réunion du Club de neuro-ophtalmologie francophone et de la présentation du Rapport.